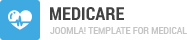Introduction
Timidement mais sûrement, le premier trimestre 2024 a été amorcé avec la planification des activités de la nouvelle année. C’est un plan consolidé de l’ensemble des pays prenant en compte les priorités nationales ainsi que toutes les récentes évolutions dans le secteur sérieusement marqué par le changement climatique d’une part et les crises humanitaires d’autre part. En lien avec le plan stratégique 2021-2025, le plan d’action est décliné dans ses quatre axes avec un accent particulier sur les performances institutionnelles et organisationnelles. Le rayonnement de l’agence sur le continent et au-delà est un gage d’attractivité et de confiance devant fédérer les efforts de mobilisation des partenariats et des ressources.
En dehors des activités de recherche qui se sont poursuivies au Congo et au Cameroun, c’est la mise en œuvre des projets et programmes ainsi que le renforcement des capacités qui ont occupé l’essentiel de l’agenda du trimestre. C’est ainsi que les cadres de concertation des parties prenantes, les revues annuelles des politiques et programmes pays, les rencontres programmatiques avec les acteurs, ont vu la participation active des experts de l’agence EAA. Par ailleurs, d’inlassables efforts ont été déployés dans la recherche de financements afin de renflouer le portefeuille des programmes sérieusement entamé par la clôture de certains projets au Congo, au Sénégal, au Benin et au Burkina Faso. A cet effet, plusieurs accords de partenariat ont été signés et de nouvelles initiatives ont été développées dont les fruits se ressentiront probablement dans les mois à venir. D’ores et déjà, le dossier d’appel à manifestations d’intérêt soumis en consortium à l’ONAS au Sénégal a été présélectionné pour soumettre la demande de propositions.
Même si très peu d’appels à projets et à manifestations d’intérêt ont été soumis au cours de la période contrairement aux accords de partenariats signés en si grand nombre, il n’en demeure pas moins que le dispositif de veille situationnelle reste actif partout dans les bureaux. La soumission des offres de services s’accentuera dans les mois à venir et ce, toujours en consortium avec les autres partenaires, afin de mutualiser nos expertises et accroitre notre degré de compétitivité dans un monde de plus en plus exigeant en termes d’assurance-qualité.
Toutes ces actions requièrent un accompagnement substantiel des Etats pour assurer les charges minimales de fonctionnement et un déploiement sur le terrain pour le suivi des activités. A date, seul le Cameroun a pu apporter, en différé, sa contribution de l’exercice 2023 permettant à l’agence de faire face à ses charges incompressibles et honorer ses engagements vis-à-vis de ses fournisseurs et prestataires de service.
En cette fin du premier trimestre, le dossier du Conseil des ministres a connu une évolution qualitative avec la signature du document portant Communication en Conseil des Ministres (CCM) en Côte d’Ivoire. Ce document clé signé par quatre (4) ministres du gouvernement ivoirien présente la situation globale de l’agence et le budget prévisionnel du Conseil. Reste maintenant à caler d’accord parties la date de la session des ministres de EAA. Fort probablement, le deuxième trimestre verra la tenue effective du Conseil des ministres tant attendu.
Couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, le présent rapport rend compte des réalisations du premier trimestre de l’année.
- Recherche-action pour le développement et la promotion des innovations technologiques
Seuls le Cameroun et le Congo ont poursuivi les activités de recherche-action en ce début d’année.
1.1. Cameroun
Poursuite de l’encadrement des stagiairesde l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics sur le développement des solutions alternatives d’approvisionnement en eau et d’assainissement à faible coût dans un contexte de décentralisation et sur la médiation environnementale et sociale, avec la collaboration de l’Association Jeunesse Verte pour l’Environnement
1.2. Congo
- L’enquête auprès des ménages dans trois secteurs de Brazzaville se poursuit dans le cadre du projet d’inventaire des abonnés de LCDE
- Dans le cadre du projet des 60 écoles, une enquête finale est en cours en vue de la capitalisation des acquis.
2.Mise en œuvre des projets et programmes
Le tarissement de certains financements à la fin 2023 a affecté sérieusement les programmes en ce début d’année. Pendant que le Niger est en phase de capitalisation avec IPAR, les autres pays sont en pleine négociation du renouvellement de leurs financements. C’est le cas du Tchad et du Congo dont les dossiers sont bien avancés. Les nouveaux partenariats noués au cours de ce trimestre offrent de nouvelles opportunités de financements à capter et ouvrent des passerelles vers des programmes régionaux d’envergure qu’il faut suivre patiemment jusqu’à leur aboutissement. Il en est de même des projets individuels soumis par pays à des bailleurs bien intéressés par le secteur et particulièrement par le sous-secteur assainissement.
Les activités réalisées en cette période de l’année sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Tableau de bord du portefeuille des bureaux pays
|
Pays |
Intitulé du projet |
Partenaire financier |
Client |
Période |
Observations |
|
Benin |
Programme AGIR Eau sur la gestion des eaux usées et boues de vidange |
GIZ/AGIR Eau |
Grand Nokoué et les communes de Djougou et Lokossa |
2024 |
Deux activités principales sont retenues pour 2024 : - Evaluation à mi-parcours sur la gestion des eaux usées et des boues de vidange - Formation du personnel AGIR-Eau par EAA sur la gestion des eaux usées et des boues de vidange |
|
Promouvoir la gestion durable des eaux souterraines et l’irrigation régénératrice pour un développement communautaire responsable |
Commission mixte Permanente Wallonie Bruxelles International-Bénin |
Territoire national |
2024-2028 |
Négociation de financement en cours |
|
|
Congo |
Renforcement du service d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans six écoles primaires de Bouenza, Pool et Cuvette |
UNICEF |
Départements de Bouenza, Pool et Cuvette |
2023-2024 |
Formation des enquêteurs pour la réalisation de l’enquête finale dans les écoles |
|
Programme d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans 60 écoles de Lékoumou, Sangha, Likouala et Plateaux |
UNICEF |
Départements de Lékoumou, Sangha, Likouala et Plateaux |
2023-2024 |
Les réalisations du trimestre sont les suivantes : - Mise en œuvre de l’assainissement total piloté par l’école (ATPE) - Mise en place des COGES et Clubs Scolaires - Formation des COGES et Clubs scolaires - Distribution de dispositif de lavage des mains dans 50 écoles - Production du rapport final |
|
|
Niger |
Mécanismes de Financement de l’Assainissement Autonome : ceux innovants et durables |
Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) |
Les périmètres urbains |
2022-2024 |
Les premiers résultats produits en cette phase de capitalisation se résument ci-après : 1. Une note d’orientation Les points saillants de cette note conçue comme outil de plaidoyer et d’aide à la décision dans le sous-secteur de l’assainissement autonome au Niger sont, entre autres : - L’analyse des progrès ainsi que les défis dans le sous-secteur de l’assainissement autonome au Niger - Le processus d’élaboration des comptes WASH Niger à travers la mobilisation des partenaires techniques et financiers, la quote-part de l’assainissement dans l’application des principes pollueurs-payeurs et préleveurs-payeurs conformément au code de l’eau du Niger, la responsabilité sociétale des entreprises et des ressortissants de la diaspora 2. Des éléments pour alimenter le kakémono et le poster Ce sont particulièrement : - Les éléments de visibilité du sous-secteur affichant les différentes parties prenantes et les principales sources de financement - Les approches de promotion de l’assainissement |
|
Sénégal |
Projet Eau Assainissement en Milieu Rural (PEAMIR) |
Banque Mondiale |
Région de Diourbel |
2022-2024 |
Finalisation des 100 derniers ouvrages d'assainissement dans les 4 villages restants à raison de 25 ouvrages par village (Gallo Ngoye, Peye Ngoy 1, Battal, Darou Ndiouly) |
|
Tchad |
Contrat programme : Projet de réhabilitation des forages équipés de pompes à motricité humaine (PMH) dans les écoles des 10 arrondissements de la commune de Ndjamena |
Etat Tchadien |
Territoire national |
2021-2025 |
Suivi et accompagnement des 10 arrondissements de la ville de Ndjamena dans la gestion durable des points d’eau mis en place |
3.Renforcement des capacités des acteurs
Comme évènement majeur en ce début d’année fiscale, les revues annuelles des programmes et politiques sectorielles ont focalisé l’attention des différentes parties prenantes. A cela s’ajoutent des sessions de formation des acteurs et des groupes de réflexion en vue d’une meilleure planification de l’année 2024.
Burkina Faso
Participation au suivi de la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales en matière d’hygiène, d’assainissement et d’eau potable.
- Revue annuelle 2023 du Cadre Sectoriel dedu secteur « Environnement, Eau et Assainissement » (CSD-EEA)
La Revue annuelle 2023 du cadre sectoriel de dialogue du secteur « Environnement, Eau et Assainissement » (CSD-EEA) s’est tenue le 27 février 2023 dans la salle de conférence du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement sous la présidence du Ministre de l’Environnement de l’Eau et de l’Assainissement, Monsieur Roger BARO par ailleurs Président du CSD-EEA.
Etaient également présents à cet atelier le ministre en charge de l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat, Mikailou SIDIBE vice-président du Cadre sectoriel de dialogue "Environnement, Eau et Assainissement ".
La rencontre a regroupé l’ensemble des acteurs du secteur de planification ainsi que les partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales, les collectivités territoriales et le secteur privé intervenant dans le secteur.
La rencontre a permis d'examiner et de valider le rapport de performance annuelle 2023 du CSD-EEA ainsi que le projet de PA-SD-EEA (Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement du secteur « Environnement, Eau et Assainissement », actualisé et de formuler des recommandations pour une amélioration des interventions du secteur.
En termes de bilan, il faut noter que les résultats ont été jugés satisfaisants.
Pour ce qui concerne le pilier réponse à la crise humanitaire, notamment les réalisations au profit des Personnes Déplacées Internes (PDI), on note la réalisation de 99 forages équipés de pompe à motricité humaine, 30 postes d’eau potable simplifiés, 3 adductions d’eau potable simplifiées, 3009 latrines familiales, 473 blocs de latrines communautaires et 1408 foyers améliorés.
Concernant le pilier refondation de l’Etat et amélioration de la gouvernance, les réalisations sont entre autres :
En outre, on note la collecte de 566 680 tonnes de déchets domestiques dans les communes, 18,753 km de linéaires de caniveaux réalisés, 26,7 ha d’espaces verts reboisés, 210 km de plantations d’alignement, la protection de 12 berges de retenues d’eau,l’élimination de plantes envahissantes de SDAGE de l’agence de l’eau du NAKANBE, portant le nombre d’agence de l’eaudisposant de SDAGE à trois (03). Aussi, on retient l’élaboration et la mise en œuvre en cours de 22 Plans de Développent Intégrés Communaux (PDIC), le renforcement des investissements dans 15 villages en transformation en éco village, l’installation de 245 stations météorologiques automatiques dans les communes et la diffusion de 755 bulletins d’informations météorologiques et climatiques.
Le ministre Roger BARO a exprimé sa gratitude aux PTF pour leur appui constant aux structures en dépit du contexte sécuritaire et son corollaire de crise humanitaire.
La rencontre a aussi permis de formuler des recommandations pour accroître les performances du secteur dans la mise en œuvre des orientations.
Au titre des recommandations l’on peut retenir :
- L’organisation de rencontres pour l’assurance qualité après le travail du secrétariat
- L’implication de toutes les parties prenantes
- L’identification et la responsabilisation des acteurs locaux (OSC, ONG)
- Atelier Water AID
Depuis son installation officielle en 2003 au Burkina Faso, Water Aïd, a mis en œuvre quatre stratégies jusqu'en 2022. En avril 2023, Water Aïd a lancé sa cinquième stratégie comprenant deux programmes clés : l'accroissement du financement du secteur Eau, Assainissement et Hygiène (EAH) et le développement de services WASH résilients au changement climatique.
Selon les perspectives climatiques, le pays se dirige vers une augmentation de la température estimée entre 1,9 et 4,2°C d'ici à 2080, accompagnée de phénomènes de sécheresse et d'inondations sporadiques. Une observation majeure est la tendance à l'aridification croissante du pays, marquée par une migration des isohyètes du nord vers le sud. Cette migration des isohyètes a pour conséquence une redéfinition des zones climatiques, avec une avancée d'environ 100 km vers le sud des zones plus sèches.
Ces changements climatiques impactent considérablement les zones agro écologiques du Burkina Faso, entraînant une baisse de la biodiversité et une augmentation de la vulnérabilité des ressources en eau. Les ressources naturelles, notamment l'eau, subissent des pressions croissantes en raison de la raréfaction des précipitations et des variations climatiques de plus en plus marquées.
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie pour la période 2023-2028, Water Aïd au Burkina Faso s'est engagé à renforcer la résilience des services EHA face aux défis du changement climatique. L'un des principaux objectifs de ce programme est d'adapter les services EHA pour les rendre résilients au changement climatique et accessibles à l'ensemble de la population burkinabè. Ainsi, Water Aïd Burkina Faso a organisé un atelier visant à mener des réflexions sur l’adaptation des technologies WASH aux effets du changement climatique, marquant ainsi son engagement à relever ces défis cruciaux.
L'objectif principal de cet atelier était de faire des propositions d’adaptation des technologies EHA existantes en vue de les rendre plus résilientes aux effets du changement climatique.
Plus spécifiquement il s’est agi de :
- Analyser les tendances actuelles du changement climatique au Burkina Faso et leurs impacts sur l'accès à l'eau, l'hygiène et l’assainissement
- Proposer des adaptations aux modèles technologiques spécifiques au Burkina Faso pour renforcer la résilience des systèmes WASH face aux effets du changement climatique
- Promouvoir la collaboration entre les acteurs du Burkina Faso pour développer des solutions intégrées
Cet atelier a été organisé avec l’appui de la Direction Générale de l’Assainissement des Eaux Usées et Excreta (DGAEUE), la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP), la Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DGEVCC) et le Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP/CNDD) et a connu la participation des acteurs clés de l’eau et de l’assainissement
- Atelier de validation des livrables de l’étude de capitalisation des innovations techniques et technologiques
Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 « Etude et renforcement de capacités » du projet de Promotion de l’Hygiène, de l’Eau Potable, de l’Assainissement et de renforcement de la résilience de la population à la COVID 19 et au changement climatique en milieu rural dans 08 Provinces au Burkina Faso (PHEPA-8P), le bureau pays de EAA au Burkina Faso a participé à l’atelier de validation des livrables de l’étude de capitalisation des innovations techniques et technologiques le 28 mars 2024 dans la salle de réunion du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Agricoles (SP-CPSA).
L’atelier qui a été organisé par la DGAEUE, a permis d’examiner et de valider le rapport d’étude de capitalisation des innovations techniques et technologiques des ouvrages d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta.
En effet, le PHEPA-8P vise à contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de santé des populations rurales de huit provinces dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Sud et du Plateau Central.
Pour une mise en œuvre réussie des actions, une capitalisation des innovations techniques et technologiques des ouvrages d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta au Burkina Faso s’avère nécessaire.
Pour la présidente de l’atelier, Madame Diane SOME, Chargée d’Etudes, représentant Monsieur le Secrétaire General du Ministère de l’environnement, de l’Eau et de l’Assainissement « cette étude revêt une importance capitale pour le sous-secteur de l’assainissement de eaux usées et excreta car elle contribuera à améliorer le service d’assainissement conformément à l’AFDH et assurer une meilleure intervention des acteurs pour l’atteinte des objectifs au niveau national »
Cette étude contribuera également à l’opérationnalisation de l’objectif spécifique n°4 du Programme National de l’Assainissement des Eaux et Excreta (PN-AEUE) « Développer la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excreta en soutien à l’amélioration de l’offre technologique et des pratiques ».
L’atelier a permis de faire l’état des lieux des innovations techniques et technologiques existants dans le sous-secteur de l’assainissement des eaux usées et excreta.
Le rapport de capitalisation de ces innovations a été présenté aux acteurs qui ont apporté leurs amendements.
A l’issue des échanges, le document a été soumis à la validation de l’ensemble des participants
Congo
Formation des enquêteurs pour la réalisation de l’enquête finale dans les 10 écoles de la Lékoumou
Enquête finale dans les 10 écoles de Lékoumou
Niger
Présentation d’une note d’orientation faisant ressortir les principales conclusions et recommandations issues de l’analyse SWOT de « l’évaluation des mécanismes de financement du sous-secteur de l’assainissement autonome au Niger (ceux innovants et durables) », et prend en compte les éléments nouveaux de la recherche et de l’analyse documentaire en vue d’appréhender les tenants et aboutissants de cette capitalisation
- Vue synoptique du kakémono
|
PROJET WASPA WEST AFRICAN SANITATION POLICY & ACTIVATORS |
MECANISMES DE FINANCEMENT DU SOUS SECTEUR DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME AU NIGER |
|
|
FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT AU NIGER |
DEFIS MAJEURS |
INNOVATIONS |
|
Principales sources de financement : Ménages : ND |
Sous financé par l’Etat : 5% du besoin de certification d’une commune sans subvention aux ménages |
Mise en œuvre du marketing de l’assainissement Mobilisation du financement des opérateurs privés L’investissement par le fonds SMEA des CT Mobilisation de la diaspora |
|
RECOMMANDATIONS |
|
|
|
PLAN D’ACTIONS |
|
|
|
PROJET WASPA WEST AFRICAN SANITATION POLICY & ACTIVATORS |
MECANISMES DE FINANCEMENT DU SOUS SECTEUR DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME AU NIGER |
|
Approche Communale WASH basée sur le changement de comportement et la promotion des bonnes pratiques en HA sans subvention aux ménages |
Approche basée sur le marché Renforcement du marché et de la chaîne d'approvisionnement en produits et services d'assainissement |
Approches de financement Utilisation des mécanismes de financement pour augmenter l'adhésion des personnes non desservies |
|
|
Faible performance de l’assainissement autonome au Niger se traduisant par un très fort taux de défécation à l’air (84% en 2022 en milieu rural) dont les principales causes sont, entre autres :
- Le sous financement de l’assainissement autonome, à peine 5% du besoin pour certifier une commune
- La non fonctionnalité des différents organes de coordination (comités ATPC)
- La faible participation du secteur privé au financement de l’assainissement autonome
4.Performance organisationnelle
Une percée importante a été faite en ce début d’année dans le renforcement de la visibilité de l’agence et de son rayonnement. De nouveaux partenariats ont été noués, lesquels porteront l’image de l’agence au-delà de l’Afrique. De même, des accords de collaboration interne ont été signés avec les pays pour un accompagnement de proximité comme c’est le cas du Sénégal.
4.1. Plan d’action 2024
Tirant les leçons des années précédentes et particulièrement de 2023, le plan d’action de 2024 est plus réaliste et réalisable. Fortement adossée au plan stratégique 2021-2025, la planification 2024 est en cohérence avec les plans nationaux ainsi que les engagements régionaux et internationaux pris par les Etats. D’un montant global de 3 797 013 643 FCFA, cette planification consolidée est déclinée suivant les quatre axes du plan stratégique et ambitionne de contribuer substantiellement à l’atteinte de la vision africaine de l’eau 2025 et tirer les pays vers l’échéance 2030 des ODD.
La mobilisation d’un tel budget pour la mise en œuvre du plan 2024 appelle à une diplomatie agressive et une collaboration active entre les acteurs en particulier les équipes pays et le siège. Des appels à projets et à manifestation d’intérêts doivent être intensifiés ainsi qu’un suivi méticuleux de tous les dossiers de financement en cours. Les nombreux accords signés en début d’année avec les nouveaux partenaires participeront de cette stratégie de mobilisation en vue de capter toutes les niches de financement qui en découlent.
4.2. Signature d’accords de partenariat
Des accords importants ont été signés avec de grandes firmes et institutions de recherche pour la promotion de nouvelles technologies. Il s’agit notamment de :
- Planète Construction: Avec son expertise de pointe dans la potabilisation de l’eau par injection des flux (et non le chlore), cette institution basée en Suisse a noué en mars 2024 un partenariat doublement bénéfique pour EAA. Il s’agit d’une part du partage des technologies et d’autre part de la mobilisation des ressources auprès des donateurs et fondations. A cet effet, elle représente officiellement EAA en Europe et au Moyen Orient dans cette mobilisation des partenariats et des ressources.
- PEN: Centre de recherches basé en Afrique du Sud, PEN CT est très actif dans les domaines de recherche en énergies renouvelables, eau potable et assainissement. Opérant principalement dans les régions australes et orientales de l’Afrique, le centre étendra ses activités dans le reste de l’Afrique grâce à ce partenariat signé avec EAA en février 2024. Désormais, les deux institutions mutualiseront leurs efforts dans la mobilisation des ressources ainsi que dans le partage d’expériences et d’expertise en matière de recherche dans leurs domaines de concentration respectifs.
- La Région 6 de l’: C’est la sixième région de l’Union Africaine qui regroupe toute la diaspora africaine dans le monde. Adossée à sa banque, c’est-à-dire la banque centrale de la diaspora africaine (ADCB) logée en Jamaïque, la région 6 s’engage à financer l’ensemble des activités de l’agence EAA partout en Afrique. Des arrangements financiers sont en cours en vue d’autoriser les premiers déboursements dès le mois de mai 2024.
Photo famille après signature du partenariat à Accra avec le président de la Région 6 (au centre)
4.3. Collaboration EAA - ONAS
La convention de partenariat entre ONAS et le Bureau EAA Sénégal, a été signée et enregistrée au niveau du Bureau d’enregistrement de contrats des Impôts et domaines de Grand Dakar. Un plan de travail annuel pour l’année 2024 a été élaboré à cet effet conformément à l’article 3 de cette Convention.
En rappel, cette convention de partenariat porte essentiellement sur les points suivants :
- Recherche/Action participative
- Conception/Financement/Réalisation de projets et programmes
- Renforcement de capacités
- Capitalisation/Gestion de connaissances
4.4. Collaboration avec la DSEPPP
La Direction de Suivi et de l’Évaluation des Performances des Projets et Programmes (DSEPPP), relevant du Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC) du Sénégal, joue un rôle crucial dans l'amélioration de la gestion des projets bénéficiant du financement de la Coopération internationale. Sa mission consiste à assurer le suivi et l'évaluation des performances de ces projets, visant ainsi à optimiser leur exécution et à garantir une utilisation efficiente des ressources, répondant aux besoins des bénéficiaires de manière satisfaisante.
La collaboration entre la DSEPPP et EAA pour la réalisation de l'étude sur “Les effets des investissements hydrauliques sur la santé des enfants” a débuté par une rencontre constructive dans les locaux d’EAA. Réunis dans un esprit de coopération et d'échanges, les représentants des deux entités ont posé les bases d'une collaboration fructueuse visant à approfondir la compréhension des impacts des investissements hydrauliques sur la santé des enfants.
Cette étude revêt une importance capitale dans le contexte actuel où l'accès à l'eau potable et à des infrastructures hydrauliques adéquates reste un enjeu majeur pour de nombreuses communautés à travers le monde. Au cours de cette première rencontre, les objectifs de l'étude ont été discutés et précisés, ainsi que les méthodologies envisagées pour collecter et analyser les données pertinentes.
La collaboration entre la DSEPPP et EAA s'annonce prometteuse, bénéficiant de l'expertise et des ressources complémentaires de chaque partie. Après cette première rencontre fructueuse, les prochaines étapes consisteront à élaborer une feuille de route détaillée, à établir une convention de partenariat formelle pour encadrer la collaboration, et à finaliser les Termes de Référence de l'étude adaptés aux besoins spécifiques du projet.
Un modèle de convention de partenariat a été proposé par EAA à la DSEPPP. Une fois ces étapes franchies, la mise en œuvre concrète de l'étude pourra être entamée, en mobilisant les ressources nécessaires et en lançant les activités prévues dans le cadre de notre feuille de route. Ensemble, nous aspirons à fournir des résultats probants et des recommandations précieuses qui contribueront à orienter les politiques et les actions visant à améliorer la santé et le bien-être des enfants, en particulier dans les régions où les investissements hydrauliques sont cruciaux
4.5. Gestion des papiers administratifs
Le bureau du Sénégal a obtenu des résultats remarquables dans l'accomplissement de ses obligations en matière de sécurité sociale et a réussi à se procurer les documents administratifs nécessaires. L’agence entretient des relations transparentes tant avec ses employés qu'avec les autorités compétentes, grâce à son engagement en faveur d'une gestion rigoureuse et du strict respect des lois applicables au Sénégal.
Cette approche, très méthodique, garantit un travail assumé en toute responsabilité en vue d’honorer nos obligations sociales et renforcer la confiance de toutes les parties prenantes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation
4.6. Appels à manifestation d’intérêts et à projets
En dehors des appels à projets et des manifestations d’intérêts soumis en consortium avec ses partenaires stratégiques, l’agence s’est focalisée principalement sur la prestation de services ou la sous-traitance pour d'autres entreprises. C’est le cas du bureau du Sénégal qui a excellé ce trimestre dans la sous-traitance de ses prestations.
Le dossier de la mission d’ingénierie sociale porté par le Consortium composé de CAERD-Réseau International, E. CO.RE et EAA pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement au niveau des ménages et des établissements publics (gares, écoles, santé et marchés) lancée par l’ONAS dans le cadre du Projet d’Assainissement Autonome de la région de Dakar (PAAD) financé par la Banque Mondiale avance bien. Après la phase de présélection par l’ONAS, le consortium a soumis la demande de propositions, dernière étape du processus d’adjudication.
- Perspectives
Pour le deuxième trimestre 2024, des efforts se poursuivront pour :
- La tenue effective du Conseil des ministres
- La poursuite de la mise en œuvre des projets et programmes
- La mise en œuvre des différents accords de partenariat
- La soumission des offres
- Conclusion
L’année 2024 a commencé avec la mise en chantier du plan d’action élaboré en fin 2023 et finalisé dès le mois de janvier 2024. C’est un plan basé sur les leçons apprises des années précédentes afin d’être plus ciblé et plus réaliste. Sa mise en œuvre optimale apportera plus d’impact et de visibilité sur le terrain. C’est pourquoi les bureaux pays sont exhortés à un déploiement massif sur le terrain pour accompagner et délivrer mais aussi pour se donner les moyens d’actions à travers la mobilisation des partenariats et des ressources. L’objectif visé est d’aboutir à un taux d’exécution au-delà de 80% à la fin de l’année fiscale. A un an de l’échéance du plan stratégique, le programme de cette année doit permettre de ratisser large afin de contribuer substantiellement à l’atteinte des objectifs nationaux, régionaux et internationaux auxquels les Etats ont souscrit.
C’est pourquoi, les dossiers de financement introduits dans le pipeline des différents bailleurs doivent faire l’objet d’un suivi méticuleux et rapproché. En effet, une série d’accords a été signée en 2023 et en début 2024 avec de nouveaux partenaires qui sont intéressés par le secteur et plus particulièrement le travail de l’agence. Leur fort intérêt pour le secteur eau et assainissement, une fois matérialisé et concrétisé, apportera une valeur ajoutée certaine au portefeuille des programmes pays. A cela s’ajoutent des lettres d’intention en cours de négociations avec certains donateurs suite à la soumission des projets régionaux regroupant un ensemble de pays d’une part et des projets individuels pour certains pays spécifiques d’autre part. Aussi, quelques appels à manifestation d’intérêts souscrits sont bien suivis et des éléments complémentaires sollicités par les commanditaires ont été fournis. D’autres comme le dossier soumis à l’ONAS sont sélectionnés pour la phase finale avec la soumission de demande de propositions. Le dispositif de veille situationnelle mis en place continuera de scanner l’environnement afin de saisir toutes les opportunités de financement qui se présenteront. Aussi bien le siège, les bureaux pays que les partenaires stratégiques positionnés en Afrique et en dehors du continueront veillent régulièrement à cela.
En effet, exploitant amplement le statut d’observateur de l’agence à l’ONU, nous avons pu étendre stratégiquement notre partenariat de manière à couvrir le nord de l’Amérique et toute l’Europe centrale ainsi que le Moyen Orient. Une telle représentation accroitra la visibilité de l’agence dans ces parties du monde afin de prendre activement part aux grands Sommets qui réunissent généralement les Sommités du monde mais aussi les donateurs et les investisseurs. L’idée est d’arriver à une saturation de l’espace géographique et médiatique en vue d’une grande mobilisation en faveur du secteur eau et assainissement.
Certes les défis sécuritaires persistent dans les pays du Sahel et plus particulièrement dans les trois pays de l’Alliance des Etats du Sahel, mais une attention particulière est toujours portée au secteur. Cela se traduit par l’appui multiforme que le Burkina Faso apporte à l’agence pour son fonctionnement. En effet, le Burkina Faso est l’un des rares pays qui verse régulièrement ses contributions statutaires au fonctionnement de l’agence. Quant au Mali, la récente nomination du Point Focal apportera du sang neuf au sein du Bureau pays en vue de sa redynamisation. Vu sa principale mission, la présence du Point Focal facilitera énormément le travail du bureau dans la mobilisation des fonds pour l’implementation du WASH humanitaire dans les zones à problèmes. Les camps des réfugiés et des déplacés internes ont besoin d’un accompagnement et de l’accès aux services de base dont l’eau et assainissement.
Par ailleurs, l’exécution des projets et programmes s’est poursuivie dans quelques pays en ce début d’année. Elle s’accentuera et s’étendra au cours de l’année au fur et à mesure que des fonds sont mobilisés. La plupart des financements ayant tari, l’agence est à pied d’œuvre pour négocier des rallonges ou de nouveaux financements afin de lancer de nouveaux projets. Les grands programmes régionaux en négociation procèdent de cette option. Une fois acquis, ces financements sont durables et à fort impact en particulier dans le sous-secteur de l’assainissement productif. Ce sont des programmes intégrant le continuum assainissement-énergie-agriculture et faisant intervenir d’autres segments de la chaine comme les banques et les institutions de microfinance. Leur mise en œuvre constitue une innovation dans le secteur et réplicable par son effet de levier.
Dans l’intervalle, quelques difficultés de fonctionnement se posent. Les contributions attendues des Etats pour faire face aux charges de fonctionnement de l’agence tardent à parvenir. A date, aucune contribution de l’exercice 2024 n’a été enregistrée. Fort heureusement, le Cameroun a fait parvenir en mars sa contribution pour le compte de l’année 2023, ce qui a permis d’honorer certains engagements et d’atténuer quelque peu les charges incompressibles de l’agence. D’autres subventions sont annoncées et instamment attendues afin de soulager particulièrement le personnel sur les épaules desquels repose une grande pression de travail notamment dans la conception et le suivi des projets de haute qualité. La situation étant particulièrement difficile en 2023, l’agence intensifiera le plaidoyer auprès des Etats en vue d’inverser la tendance et de mobiliser substantiellement les contributions statutaires qui constituent l’une des sources principales et durables de financement conformément à l’article 18 de la Convention portant Statuts de EAA.
Enfin le dossier du Conseil des ministres est relancé et avance bien. Les documents essentiels y compris le budget du Conseil ont été approuvés par les ministères clés de Côte d’Ivoire. Reste maintenant au Président du Conseil des ministres de faire une communication au gouvernement ivoirien pour donner l’information officielle à l’ensemble du Cabinet. Par la suite, une date sera définitivement arrêtée pour tenir la session à Abidjan. Entre temps, les dossiers doivent être actualisés pour tenir compte des dernières évolutions jusqu’à la fin de l’année 2023. Vu la tendance globale des échanges et du niveau de préparation, il est très possible que le Conseil des ministres de l’agence se tienne au cours du deuxième trimestre 2024.